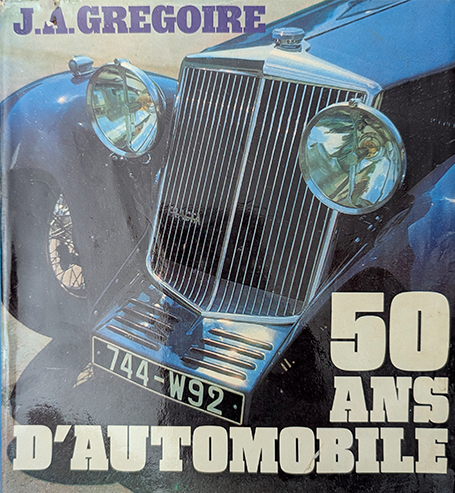Héritiers des véhicules hippomobiles, les premières automobiles reposaient sur des jantes en bois dont la fabrication et l’entretien relève de professionnels spécialisés : les artisans charrons. L’un des derniers en activité, Alain Montpied, qui exerce à Saint Ours dans le Puy de Dôme, nous raconte son parcours.

Découverte de l’atelier de restauration automobile d’Alain Montpied
Vous êtes fils et petit-fils de charron, est-ce que reprendre l’activité familiale était une évidence pour vous ?
Alain Montpied : Pas du tout non parce que mon père avait reconverti l’atelier en menuiserie et je me suis plutôt dirigé au départ vers la mécanique : je suis rentré à 14 ans, durant les vacances scolaires, chez un réparateur auto-agricole où j’ai beaucoup appris et dont je suis devenu salarié. À partir de 1984, je me suis mis à mon compte en tant que mécanicien réparateur automobile puis je suis devenu agent Renault. Pendant ce temps, j’ai commencé à regarder les samedis et dimanches comment mon grand-père travaillait ses roues car, malgré sa reconversion, l’atelier n’avait pas été trop modifié, beaucoup d’éléments de charronnage subsistaient. J’ai rencontré un ancien charron par l’intermédiaire d’un collectionneur d’attelage hippomobile qui m’a appris les bases du métier et, à la revente du garage vers 1997, j’ai démarré cette activité. J’ai d’ailleurs bénéficié d’un gros coup de pouce de Michelin qui m’a permis d’exposer sur leur stand à Rétromobile au début de mon activité.
Combien de temps faut-il pour réaliser une roue en bois automobile ?
Une roue est constituée d’un moyeu la plupart du temps à reconditionner, de rais ou de rayons et de deux demi-jantes cintrées autour, le tout encerclé d’une jante à talon. Je possède un stock d’éléments en bois cintrés d’avance, afin de leur laisser le temps de sécher et pouvoir répondre rapidement à la demande. Beaucoup de phases de travail sont longues, même si j’ai développé un système pour préparer les coupes des rayons. Cela réduit un peu ce poste de travail qui était long et fastidieux mais tout compris, il faut tout de même compter une grosse quinzaine de jours pour réaliser une paire de roues. J’essaie d’avoir plusieurs clients en même temps pour rendre le procédé de fabrication plus efficace.
Y-a-t-il encore beaucoup de demande ?
Paradoxalement, nous vivons une inversion du marché. Il y a quelques années, le gros charronnage débouchait rarement sur des chantiers alors que nous avions beaucoup de demandes de roues automobiles. Aujourd’hui, c’est plutôt le contraire : je déborde d’activité mais la demande automobile a baissé, car beaucoup d’ancêtres ont été restaurés, sont conservés dans des conditions idéales et roulent peu, si bien qu’ils demandent moins de travaux. Une roue en bois bien réalisée et conservée dans de bonnes conditions profite d’une durée de vie très longue, si bien qu’il n’existe plus vraiment de marché de renouvellement. C’est d’ailleurs vrai même pour certaines roues d’époque de très bonne qualité : je n’ai jamais refait à neuf une roue de Panhard & Levassor car elles étaient remarquablement réalisées : je les ai seulement réparées ou ajustées ! Il faut dire également que les amateurs d’ancêtres vieillissent, les voitures sortent moins.
Quel est le projet de rénovation dont vous êtes le plus fier ?
Si on reste dans l’automobile, je pense à la Brasier d’Édouard et de François Michelin restaurée en 2005 à l’occasion du centenaire de la Coupe Gordon Bennett. Il y a également une Brasier qui a participé au Pékin Paris mais aussi la reconstitution du Fardier de Cugnot dont j’ai réalisé les roues et le châssis, c’était un bon moment. À chaque fois, il y a un climat de connivence qui s’instaure entre passionnés : ce n’est plus seulement un objet qu’on livre, il y a un esprit derrière.
Que vous a apporté la qualification d’Entreprise du Patrimoine Vivant ?
Oui, c’est une grosse source de motivation car dans les métiers rares on est un peu seul, on est électron libre, on n’a pas vraiment d’organisme de représentation. Cette reconnaissance nous pousse à nous projeter, à nous regarder, à progresser en termes de qualité et d’innovation.
Comment transmettre un métier comme le vôtre ?
La transmission est évidement un sujet très important : j’ai mis en œuvre dans mon atelier un module de formation en immersion totale qui dure une semaine, qui a déjà été suivi par un certain nombre de candidats : j’y enseigne la technologie, le dessin et la réalisation d’une roue simple de charrette à la main. Pour autant, la question de la reprise de l’activité reste entière, pour moi comme pour d’autres entreprises qui sont sur le point d’arrêter.
Pour en savoir plus sur la transmission des savoirs, consultez la page ci-dessous :